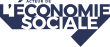En juin, la Banque nationale de Belgique a publié des statistiques sur les inégalités de revenus. La fiscalité des revenus liés au patrimoine étant moins progressive que celle liée aux revenus du travail, les ménages aux « épaules les plus larges » ne sont pas ceux qui, proportionnellement, paient le plus de charges sociales. En revanche, les mécanismes redistributifs contribuent à réduire les inégalités.
En quoi cette étude apporte-t-elle des éléments nouveaux sur les inégalités en Belgique ?
Rutger Kemels : Nous disposions déjà d’indicateurs de mesure des inégalités, mais ceux-ci ne captaient pas l’ensemble
des revenus en Belgique de manière optimale. Je pense particulièrement aux revenus du patrimoine qui sont moins bien pris en compte par les enquêtes déclaratives. Travailler sur les comptes nationaux offre l’avantage d’être le plus exhaustif possible.
Géraldine Thiry : Ce travail sur la distribution des revenus, entre autres ceux du patrimoine, commence à s’institutionnaliser.
On peut y voir une conséquence des débats sur les nouveaux indicateurs de richesse qui ont cours depuis 30 à 40 ans,
où la demande est forte de sortir des moyennes pour prendre en compte la distribution, et ainsi mieux tenir compte des situations spécifiques des gens. À cet égard, l’un des apports majeurs de l’étude de la Banque nationale réside dans la meilleure prise en compte des hauts revenus. Lorsque vous menez une enquête sur un échantillon de personnes, vous n’avez pas forcément l’ensemble des revenus qui sont représentés. Si quelques personnes captant une part considérable de revenus sont absentes de votre échantillon, cela a une tendance à déformer fortement la réalité. La prise en compte de ces hauts revenus offre donc une importante amélioration de la représentation des inégalités.
Est-ce que les inégalités de revenus augmentent ?
Rutger Kemels : Il ressort surtout de l’étude que le niveau d’inégalités était sous-estimé avec les outils que nous utilisions auparavant. Les inégalités sont un phénomène complexe, et il est difficile de les appréhender avec un seul indicateur. Sur l’évolution, lorsque l’on mesure les inégalités avec l’indice de Gini (mesure des inégalités au sein d’une population, ndlr), nous observons une certaine stabilité dans le temps. En revanche, lorsque l’on se penche sur la concentration des revenus, nous constatons une augmentation entre 2015 et 2022. Par exemple, si l’on prend 10 % de l’ensemble des revenus de tous les ménages, et que l’on regarde combien de ménages se partagent ces 10 %, on observe une plus grande concentration. En d’autres termes, on observe que le nombre des ménages qui captent ces 10 % de revenus est moins élevé en 2022 qu’en 2015. Mais on compare ici deux images fixes dans le temps, cela ne dit donc rien de l’évolution entre ces deux instantanés.
Les résultats montrent une concentration du revenu disponible plus importante parmi les plus riches, surtout dans le pourcent qui touche les revenus les plus élevés. C’est un résultat auquel vous vous attendiez ?
Laurent Van Belle : Les 10 % de ménages aux revenus les plus élevés représentent à peu près 25 % de la masse totale du revenu disponible en Belgique. On observe aussi une très grande différence entre le top 1 % et les 9 autres pourcents qui
font partie du haut de la distribution. 1 %, cela parait peu intuitivement, mais cela représente quand même
environ 50 000 ménages ou 110 000 personnes.
Géraldine Thiry : Cette étude se focalise sur les revenus. Vous pouvez avoir pendant un temps des revenus élevés pour des raisons exceptionnelles, puis des revenus plutôt dans la moyenne. Vous pouvez par exemple être dans le top 10 % l’année où vous touchez votre capital pension puis en sortir très vite. Dans cette étude, on ne regarde pas le patrimoine en tant que tel mais bien les flux de revenus qui y sont associés. Évidemment, plus longtemps vous aurez des flux élevés, plus vous allez vous constituer un patrimoine important. Généralement, les inégalités de patrimoine sont plus fortes que les inégalités de revenus. Si on veut interpréter en termes de condition de vie ce qui se passe au sein des 1 %, il faut à mon sens prendre à la fois les revenus et le patrimoine en considération.
Est-ce pour les mêmes raisons que vous avez trouvé que 42 % des ménages n’épargnent pas ?
Romain Grailet : L’épargne telle que nous la calculons pour une année est la différence entre les revenus et la consommation. Il arrive que certaines consommations exceptionnelles (achat d’une voiture, etc.) soient tellement élevées qu’elles rendent l’épargne nulle ou même négative pour une année. L’épargne négative signifie que les ménages doivent puiser dans leurs ressources existantes ou emprunter de l’argent pour satisfaire leurs besoins de consommation. Nous ne regardons que le flux d’épargne, c’est-à-dire l’épargne constituée sur une année, et non les montants déjà accumulés sur les comptes d’épargne au cours des années précédente. Le retraité qui puise sur son stock désépargne, mais cela ne dit rien de sa consommation. Les gens qui désépargnent ne sont pas nécessairement regroupés dans le bas de la distribution des revenus.
Laurent Van Belle : On ne mesure pas non plus les transferts intrafamiliaux. Un jeune qui s’installe a globalement moins, voire pas de revenus. Mais il a tout de même un loyer à payer. S’il profite de l’aide familiale, il sera reflété comme désépargnant dans notre étude. Ce chiffre de 42 % est par ailleurs en ligne avec les ordres de grandeur évoqués par d’autres sources d’information, et n’est donc en soi pas surprenant.
Les revenus du patrimoine sont plus importants pour les ménages qui ont le plus de revenus. Est-ce un raccourci de dire que ce sont ces revenus qui creusent les inégalités ?
Géraldine Thiry : On constate factuellement que le pourcentage des ménages qui capte le plus de revenus est celui où la part des revenus liés à la propriété est la plus grande. Or, les revenus de la propriété ne sont pas soumis aux cotisations sociales et sont soumis de manière plus limitée à l’impôt. Donc, ce que l’on peut dire, c’est que les mécanismes redistributifs
touchent proportionnellement moins les ménages dont la part des revenus issus du patrimoine est la plus élevée.
À l’inverse, qu’est-ce qui, selon vous, permet de réduire les inégalités ?
Géraldine Thiry : L’étude compare trois types de revenus : les revenus primaire, disponible, et disponible ajusté. Les revenus primaires sont ceux qui sont perçus avant toute forme de redistribution. Lorsque l’on regarde le revenu disponible, après cotisations et éventuelles allocations, on voit que les inégalités diminuent. Enfin, lorsque l’on observe le revenu disponible ajusté, c’est-à-dire « corrigé » en tenant compte des prestations de services publics comme l’éducation ou la santé, on observe que les inégalités diminuent encore davantage. Ce qui ressort factuellement, c’est que les mécanismes redistributifs contribuent à réduire les inégalités.
Rutger Kemels : Notre étude ne permet pas encore de mesurer l’impact des impôts indirects, comme la TVA, sur les différents groupes de ménages. Si nous intégrions cette variable dans une prochaine étude, cela permettrait d’avoir une vision encore plus fine des inégalités.
Sur la consommation justement, vous notez que l’inflation a eu un effet plus important sur les revenus les plus faibles.
Géraldine Thiry : La composition de la consommation est très différente selon la catégorie de revenus à laquelle vous
appartenez. Parmi les ménages aux revenus les plus faibles, il y a une place relativement importante de tout ce qui est lié
au logement, à l’énergie et à l’électricité. Quand on connait une crise énergétique comme celle de 2022, ce qu’on peut conclure de notre étude, c’est qu’il y a une plus grande vulnérabilité des ménages aux revenus les plus faibles lors des fortes augmentations de prix, car ces ménages y consacrent une part plus importante de leurs revenus. Pour pouvoir juger de la vulnérabilité d’une catégorie de revenus à un accroissement de prix, il est donc important de regarder la part que ces dépenses représentent proportionnellement au revenu. Et ceci ne vaut pas que pour l’énergie : il ne faut par exemple pas non plus sous-estimer l’importance de l’augmentation des prix des denrées alimentaires pour les ménages qui ont les revenus les moins élevés.
Il y a également une surreprésentation des femmes parmi les revenus les plus faibles ?
Romain Grailet : Notre analyse se fait au niveau des ménages, pas au niveau des personnes qui le composent.
Laurent Van Belle : Si notre analyse se fait au niveau de ménage, il est vrai que parmi les revenus les plus faibles, il y a une surreprésentation des femmes, adultes et enfants confondus. Elles représentent 53,6 % contre 48 % chez les revenus les plus élevés. C’est peut-être dû à la composition des familles monoparentales qui sont principalement constituées de femmes, mais notre étude ne nous permet pas de tirer de conclusion sur ce point.